En 2000, aux Etats-Unis, un sondage commandé par Time Magazine avait révélé que, quand on demandait aux gens s’ils pensaient faire partie du 1% des Américains les plus riches, 19% répondaient affirmativement, tandis qu’un autre 20% estimait que ça ne saurait tarder. L’éditorialiste David Brooks l’avait cité dans un article du New York Times intitulé « Pourquoi les Américains des classes moyennes votent comme les riches - le triomphe de l’espoir sur l’intérêt propre » (12 janvier 2003). Ce sondage, disait-il, éclaire les raisons pour lesquelles l’électorat réagit avec hostilité aux mesures visant à taxer les riches : parce qu’il juge que celles-ci lèsent ses propres intérêts de futur riche. Dans ce pays, personne n’est pauvre : tout le monde est pré-riche. L’Américain moyen ne considère pas les riches comme ses ennemis de classe : il admire leur réussite, présentée partout comme un gage de vertu et de bonheur, et il est bien décidé à devenir comme eux. A ses yeux, ils n’accaparent pas des biens dont une part devrait lui revenir : ils les ont créés à partir de rien, et il ne tient qu’à lui de les imiter (1). Il ne veut surtout pas qu’on les oblige à partager ou à redistribuer ne serait-ce qu’une petite part de leur fortune : cela égratignerait le rêve. « Pensez-vous vraiment, interrogeait David Brooks, qu’une nation qui regarde Katie Couric [présentatrice du journal du matin sur NBC, passée depuis au journal du soir sur CBS] le matin, Tom Hanks le soir et Michael Jordan le week-end entretient une profonde animosité à l’égard des nantis ? »
Dans le modèle marxiste, le travailleur est invité à se défaire de la mentalité servile et autodépréciative qui lui interdit de comparer son sort à celui des riches pour revendiquer sans complexes le partage des richesses. En même temps, il s’identifie à ses semblables, salariés ou chômeurs, nationaux ou étrangers, envers qui il éprouve empathie et solidarité. Le génie du libéralisme a été de renverser ce schéma. Désormais, le travailleur s’identifie aux riches, et il se compare à ceux qui partagent sa condition : l’immigré toucherait des allocs et pas lui, le chômeur ferait la grasse matinée alors que lui se lève à l’aube pour aller trimer... Bien sûr, on peut essayer de le raisonner ; on peut lui dire qu’il faut se méfier de ces fausses évidences dont, en France, Le Pen, puis le clan Sarkozy, se sont fait une spécialité : son intérêt objectif, en tant que travailleur, ce serait au contraire que les chômeurs ronflent béatement jusqu’à des deux heures de l’après-midi, puisque, s’ils sont obligés d’accepter n’importe quel boulot, cela tire vers le bas le niveau des rémunérations et des conditions de travail de l’ensemble des salariés - y compris les siennes. On peut essayer de lui démontrer par a + b qu’il se trompe d’ennemis, et qu’il ferait mieux de réserver sa défiance et son animosité à ces politiciens méphitiques qui encouragent en lui l’aigreur et le ressentiment les plus infects.
Pourquoi vouloir encore
changer les choses si,
à n’importe quel moment,
un coup de chance,
ou vos efforts acharnés,
peuvent vous propulser
hors de ce merdier ?
On est forcément tenté d’argumenter, et il faut le faire ; mais il faut peut-être aussi être conscient que ça ne suffit pas. Tous ceux qui, en France, ces derniers mois, écœurés d’entendre des types nés avec une cuillère en or dans la bouche marteler sur toutes les antennes les vertus du « mérite », effarés de voir tant d’agneaux se préparer à voter avec enthousiasme pour le grand méchant loup, se sont époumonés à dénoncer l’arnaque et à en démonter les mécanismes - en vain -, ont peut-être négligé un fait capital : ce qui n’a pas été fait par la raison ne peut pas être défait par la raison. Quand on a consacré un livre à tenter de démêler les formes de rêve bénéfiques de celles qui travaillent contre le rêveur, l’élection présidentielle apparaît comme le triomphe éclatant des secondes. Comme cela a été abondamment souligné depuis le 6 mai au soir, lorsque nos yeux se sont brutalement dessillés en même temps que la Marseillaise de Mireille Mathieu nous déchirait les tympans, en France, les noces de la politique et du showbiz ont été un peu plus tardives qu’ailleurs, mais elles ont fini par se produire aussi (2). Il était inexorable qu’elles finissent par se produire. Comme celle d’un Berlusconi ou d’un Reagan - qui ne venait pas du cinéma par hasard, et qui ne faisait qu’accentuer une tendance amorcée avec Kennedy -, la victoire de Nicolas Sarkozy en France résulte d’une manipulation à grande échelle des imaginaires. Elle a été préparée par vingt ans de TF1 et de M6, de presse people, de jeux télévisés, de Star Ac et de superproductions hollywoodiennes. Pour pouvoir ricaner en toute tranquillité des beaufs qui ont voté Sarkozy, d’ailleurs, il faudrait pouvoir prétendre avoir échappé complètement à l’influence de cette culture - ce qui ne doit pas être le cas de beaucoup de monde.
Le thème récurrent sur lequel tous ces médias ne cessent de broder d’infinies variations, et auquel nos cerveaux, de gauche comme de droite, ont développé une accoutumance pavlovienne, c’est celui de la success story. Qui véhicule un seul message : pourquoi vouloir changer les choses ou se soucier d’égalité des droits, si, à n’importe quel moment, un coup de chance, ou vos efforts acharnés, ou une combinaison des deux, peuvent vous propulser hors de ce merdier et vous faire rejoindre l’Olympe où festoie la jet-set ? « Chacun aura sa chance », clamait Nicolas Sarkozy à peine élu. Il y a quelques années, on avait relevé une illustration presque caricaturale de cette idéologie dans le film de Steven Soderbergh Erin Brockovich seule contre tous (avec Julia Roberts), à l’impact d’autant plus fort qu’il était inspiré d’une histoire réelle - même s’il avait apparemment fallu, pour écrire le scénario, éluder certains aspects d’une réalité moins lisse que souhaité.
Même lorsqu’on a conscience
de ses ficelles un peu grosses,
on ne peut se défendre
d’éprouver un petit frisson
au contact de la success story
Success story du gagnant du Loto. Success story du petit entrepreneur « parti de rien ». Success story du vainqueur de la « Star Ac », des acteurs et des mannequins, à qui l’on fait raconter en long et en large dans leurs interviews comment ils ont été « découverts », comment ils ont persévéré sans se laisser décourager malgré les déconvenues de leurs débuts, comment ils vivent leur célébrité et leur soudaine aisance financière, etc. Success story de la nouvelle ministre de la justice Rachida Dati, passée d’une cité immigrée de Chalon sur Saône aux ors de la République. La fonction de ministre de Rachida Dati est secondaire : ses mentors l’ont faite réussir uniquement pour illustrer la mystique - ou la mystification - sarkozyenne de la réussite. Elle est là avant tout pour faire rêver ; elle est une machine de guerre fictionnelle. Pour quiconque fait métier de raconter une histoire, Dati est du pain bénit. On lit par exemple dans Le Nouvel Economiste : « Sur son berceau, les fées ne se sont jamais penchées. Alors, elle les a inventées. Bannissant les déterminismes, forçant sa condition, son histoire est celle d’une volonté glorifiée. »
C’est la grande force de la success story : même lorsqu’on a conscience de ses ficelles un peu grosses, on ne peut se défendre d’éprouver un petit frisson à son contact. Ses ressorts narratifs sont si familiers, elle est si valorisée et valorisante, que Nicolas Sarkozy lui-même a tout fait pour y conformer sa biographie. Il lui a fallu pour cela déployer des trésors d’imagination, par exemple pour s’inventer de ces avanies, indispensables à toute success story, censées s’être gravées à jamais dans votre mémoire pour alimenter votre soif de revanche, vous forger le caractère et aiguillonner votre ambition. Le Nouvel Observateur (17 mai 2007) rapporte ainsi l’« humiliation » du nouveau président d’avoir grandi dans - on ne rit pas - le « quartier pauvre de Neuilly » : « Nicolas n’ose pas inviter ses camarades chez lui. Un souvenir le hante : le saumon fumé sous cellophane acheté au Prisunic sur lequel il tombait quand il ouvrait le réfrigérateur familial. Chez ses amis, le saumon fumé venait des meilleurs traiteurs de la ville. » Poignant, non ?
Renvoyer au passé
toute l’histoire des sciences sociales
pour les remplacer par la « philosophie politique »
et dénier aux individus
tout déterminisme social
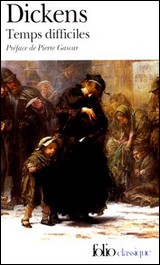 On pense à M. Bounderby, le banquier du génial roman satirique de Charles Dickens Temps difficiles : « un homme qui ne pouvait jamais assez se vanter d’être le fils de ses œuvres », et qui ne cesse de répéter que, s’il est arrivé là où il est, il ne le doit à personne d’autre qu’à lui-même. Cette fierté imbécile et forcément mensongère à l’idée de s’être « fait tout seul » rappelle ce fantasme de l’individu « autoengendré », dégagé de toutes les limites ou contraintes imposées par la nature ou la société, que décrivent dans leurs essais Nancy Huston ou Miguel Benasayag. Elle est surtout la version glamour d’une figure délibérément construite par les idéologues de la révolution conservatrice : celle d’un individu qui ne serait défini ni par ses origines sociales ou culturelles, ni par sa couleur de peau, ni par son sexe ou son orientation sexuelle - toutes caractéristiques qui seraient purement anecdotiques -, mais uniquement par son appartenance à la nation.
On pense à M. Bounderby, le banquier du génial roman satirique de Charles Dickens Temps difficiles : « un homme qui ne pouvait jamais assez se vanter d’être le fils de ses œuvres », et qui ne cesse de répéter que, s’il est arrivé là où il est, il ne le doit à personne d’autre qu’à lui-même. Cette fierté imbécile et forcément mensongère à l’idée de s’être « fait tout seul » rappelle ce fantasme de l’individu « autoengendré », dégagé de toutes les limites ou contraintes imposées par la nature ou la société, que décrivent dans leurs essais Nancy Huston ou Miguel Benasayag. Elle est surtout la version glamour d’une figure délibérément construite par les idéologues de la révolution conservatrice : celle d’un individu qui ne serait défini ni par ses origines sociales ou culturelles, ni par sa couleur de peau, ni par son sexe ou son orientation sexuelle - toutes caractéristiques qui seraient purement anecdotiques -, mais uniquement par son appartenance à la nation.
Cette entreprise passe forcément par le discrédit jeté sur ceux qui étudient les déterminations sociales et leurs effets, comme le montre Didier Eribon dans son récent livre D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française (Léo Scheer, 2007) : « Le projet de renvoyer au passé toute l’histoire des sciences sociales françaises pour les remplacer par la “philosophie politique” n’avait, au bout du compte, pas d’autre signification que celle-ci : libérer les individus de tout déterminisme social, afin qu’ils se déterminent librement et rationnellement à renoncer à leur liberté au profit de la souveraineté politique qui s’incarne dans l’Etat, représentant de la Société et de la Nation. » C’est bien d’« individus » qu’il s’agit, et non plus de « sujets » : car « le “sujet” contrairement à l’“individu” sait que la Société le précède et se situe au-dessus de lui et, par conséquent, il n’a pas la désastreuse illusion qu’il peut inventer le social au gré de ses “désirs” ».
Ce sont bien les mouvements sociaux
qui maintiennent en vie
l’idéal du bien commun
Derrière cette fiction, promue par les conservateurs, d’une nation comme « emballée sous vide », constituée d’individus dont le poids ou la marge de manœuvre respectifs seraient identiques de fait - et pas seulement dans les idéaux que proclament les frontons des mairies -, se cache une entreprise de liquidation de la politique : « Dénier le caractère constitutif des inscriptions sociales ne les fait pas disparaître, écrit encore Eribon, mais cherche à interdire qu’on lutte contre les dominations qu’elles commandent. » Pour mieux les affaiblir, on qualifie désormais les revendications collectives de « corporatistes » ou de « communautaristes » : on reproche à ceux qui les portent de mettre en péril l’intérêt général ou la cohésion de la nation. A lire Didier Eribon, on mesure mieux l’inconscience de ceux qui, tout en se réclamant de la gauche, croient pouvoir joindre leurs voix à ce concert douteux.
D’autant qu’il ne faut pas s’y tromper : même si une approche superficielle peut faire envisager leur démarche comme la défense d’intérêts particuliers, ce sont bien les mouvements sociaux qui maintiennent en vie l’idéal du bien commun. Ils rappellent que, s’il existe bel et bien une marge de manœuvre individuelle, il est absurde de vouloir faire croire que celle-ci peut être autre chose qu’une marge, justement : pour le reste, chacun est bien le produit de déterminismes qui le rattachent à divers groupes, et qui facilitent ou empêchent sa progression. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut se dispenser d’en tenir compte, et de chercher les moyens d’y remédier. Nier l’importance de ces déterminismes, et vouloir qu’il y ait société sans qu’ils aient d’abord été vaincus, c’est mettre la charrue avant les bœufs, et prendre ses désirs pour des réalités. Si les mouvements sociaux suscitent une telle hostilité, c’est parce qu’ils rappellent cette vérité contrariante.
Si on exhibe quelques spécimens
de catégories socialement défavorisées
à qui on a « donné leur chance »,
c’est pour mieux se dédouaner
de la relégation dans laquelle
on souhaite maintenir tous les autres
Pour sa part, l’idéologie conservatrice, si elle exalte la grandeur de la nation, ne fait en réalité aucun cas, évidemment, de l’intérêt général ou du bien commun. Dans cette compétition généralisée qu’est la société telle qu’elle la conçoit, et où elle feint crapuleusement de croire que tous auraient les mêmes chances, chacun est, comme Erin Brockovich, « seul contre tous ». Dans le slogan électoral de Nicolas Sarkozy, « ensemble, tout devient possible », le « ensemble » n’est là que pour décorer. Ou plutôt, il désigne un « ensemble » effroyablement pasteurisé, expurgé de tous ses éléments non conformes ; car, si on exhibe quelques spécimens de catégories socialement défavorisées à qui on a « donné leur chance », c’est pour mieux se dédouaner de la relégation dans laquelle, contrarié par leur existence, on souhaite maintenir tous les autres. A cet égard, toute recomposée qu’elle est, la prétendue « famille d’aujourd’hui » que formerait le clan Sarkozy, et qui fait cette semaine la couverture de Paris-Match, véritable débauche de gosses de riches blonds aux yeux bleus, évoque davantage les héritiers monégasques que la diversité de la France contemporaine.


« Tout est possible » : comme le rappelait Christian Salmon dans un article du Monde diplomatique (novembre 2006), reprenant une citation exhumée par Serge Halimi dans Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, ce slogan était déjà celui de Ronald Reagan lorsque, dans son discours sur l’état de l’Union, en 1985, il présentait sa Rachida Dati à lui : « Deux siècles d’histoire de l’Amérique devraient nous avoir appris que rien n’est impossible. Il y a dix ans, une jeune fille a quitté le Vietnam avec sa famille. Ils sont venus aux Etats-Unis sans bagages et sans parler un mot d’anglais. La jeune fille a travaillé dur et a terminé ses études secondaires parmi les premières de sa classe. En mai de cette année, cela fera dix ans qu’elle a quitté le Vietnam, et elle sortira diplômée de l’académie militaire américaine de West Point. Je me suis dit que vous aimeriez rencontrer une héroïne américaine nommée Jean Nguyen. » Après avoir fait ovationner la jeune femme, Reagan enchaînait sur une autre histoire, tout aussi édifiante, avant de dévoiler la morale des deux récits en s’adressant à leurs protagonistes : « Vos vies nous rappellent qu’une de nos plus anciennes expressions reste toujours aussi nouvelle : tout est possible en Amérique si nous avons la foi, la volonté et le cœur. »
L’« industrie du rêve »
ne donne pas envie au rêveur
de s’organiser avec les autres
pour améliorer ses conditions d’existence,
mais plutôt de trouver le moyen
de fausser compagnie à tous ces losers
Pourquoi mettre en place des politiques égalitaires, redistribuer les richesses, garantir à tous des conditions de vie décentes et épanouissantes, quand on peut se contenter d’accréditer la fable selon laquelle « si on veut vraiment réussir, on peut » ? Pourquoi se fatiguer à ôter les obstacles qui se dressent sur le chemin des plus défavorisés, quand on peut se contenter de couvrir d’éloges ceux qui, parmi eux, ont le jarret assez souple pour sauter par-dessus - en insinuant sournoisement, par la même occasion, que les autres doivent quand même être un peu feignasses s’ils n’y arrivent pas eux aussi ? Pourquoi se tuer à satisfaire les revendications du peuple quand on peut le payer de mots - et de belles histoires ? Car la success story n’est que la déclinaison principale de cette stratégie politique qui, comme le pointe Salmon dans son article, consacré au storytelling, consiste désormais, plus largement, à raconter des histoires. Il cite un ancien conseiller de Bill Clinton qui constatait en 2004 : « Les républicains disent : “Nous allons vous protéger des terroristes de Téhéran et des homosexuels de Hollywood.” Nous, nous disons : “Nous sommes pour l’air pur, de meilleures écoles, plus de soins de santé.” Ils racontent une histoire, nous récitons une litanie. »
C’est peut-être sous cet angle, effectivement, qu’il faut analyser la faiblesse actuelle de la gauche : sous l’angle d’un problème avec l’imaginaire. L’industrie du spectacle, qui produit les histoires et les mythes contemporains les plus puissants, est le plus souvent en affinité profonde avec l’ordre du monde : les histoires et les mythes qu’elle met en circulation sont des histoires et des mythes de droite et travaillent pour la droite, même s’ils ne se présentent pas toujours sous cette étiquette. Ils en colportent les valeurs et la vision du monde. Ce rouleau compresseur culturel rend presque impossible la tâche de la gauche - ou du moins d’une gauche qui se voudrait fidèle à ses valeurs. L’« industrie du rêve » lui coupe l’herbe sous les pieds. Car elle produit du rêve, certes, mais aussi, à part égale, de la haine de soi. Elle apprend au public que tous ceux qui ne correspondent pas à ses critères de richesse, de pouvoir, de succès, d’élégance vestimentaire et/ou de perfection plastique sont ringards et méprisables (3) ; en lui étalant au visage la réussite et la félicité de ses stars, elle l’humilie, elle entretient sa rage et sa frustration. Quand, détournant les yeux de la page ou de l’écran, il regarde autour de lui, il n’a pas envie de s’organiser avec les autres pour améliorer les conditions d’existence qu’il partage avec eux : il cherche plutôt le moyen de fausser compagnie à tous ces losers, et de fuir les endroits minables où il végète injustement avec eux. La sorte de rêve produite par la société du spectacle est celle que Flaubert - comme j’ai essayé de le montrer dans La tyrannie de la réalité - avait déjà parfaitement décrite dans Madame Bovary, alors que ce système était balbutiant : un rêve qui, au lieu de conforter le rêveur, de lui permettre d’enrichir et d’approfondir le monde dans lequel il vit, produit au contraire chez lui une « passion de la rectification », une colère aussi stérile qu’inépuisable, dans laquelle il peut finir par engloutir toute son énergie, contre la non-conformité et l’insuffisance de ce qui l’entoure.
La valorisation culturelle
de la noirceur se traduit
par une méfiance instinctive
envers tout projet politique
qui ne diabolise pas
des catégories sociales entières,
renvoyé à un conte pour enfants
De surcroît, on peut se demander si un certain snobisme culturel de masse, valorisant le cynisme comme un signe de sagesse suprême, n’a pas contribué à discréditer le projet même de la gauche, présenté comme naïf dans la mesure où il implique d’envisager la société comme une communauté solidaire, et non comme un agrégat d’individus en guerre les uns contre les autres. Avec le recul, il est frappant de constater le boulevard idéologique qu’a ouvert au sarkozysme le succès d’un Michel Houellebecq. Il a semé l’idée que des personnages veules et méprisants, prônant l’autodéfense, crachant leur haine des féministes ou des Arabes, portaient le seul regard lucide et objectif sur l’état de la société et les options politiques à notre disposition. S’il a été promu et encensé par le milieu littéraire, c’est en vertu de cette échelle de valeurs, décrite par Nancy Huston dans Professeurs de désespoir, qui fait de la noirceur un critère de qualité et de supériorité : « Hugo, Dumas, Balzac, Sand : ces auteurs vous apprenaient quelque chose sur la vie humaine, ils ouvraient des portes, fouillaient les tréfonds de l’âme, cherchaient la nuance (...). Dans un deuxième temps, pour des raisons historiques faciles à saisir, il a été admis que le message d’un roman pût être noir, simplifié, absolutiste, désespérant même, du moment que l’ensemble était “racheté” - c’est-à-dire humanisé, moralisé - par un très haut style (Beckett, Cioran, Bernhard). Mais, peu à peu, on s’est mis à confondre noirceur et excellence, à prendre la noirceur comme telle pour une preuve d’excellence. (...) Voilà le progrès : on est passé des pierres précieuses... aux diamants noirs... au tas de charbon. »
Sur le plan politique, cette valorisation exclusive de la noirceur se traduit par une méfiance instinctive envers tout projet qui ne diabolise pas des catégories sociales entières, immédiatement renvoyé à un conte pour enfants. Elle sabote ainsi à la racine le projet même de la gauche, qui implique forcément de parier, à un moment ou à un autre, sur une altérité vécue positivement - et non comme une menace. Quoi qu’on pense de Ségolène Royal, on peut d’ailleurs se demander si les clips UMP qui circulaient sur Internet au cours de la campagne présidentielle, et qui la brocardaient en la renvoyant à cette image gnangnan, ne devaient pas autant à cet avantage idéologique conquis par la droite qu’aux faiblesses de la candidate socialiste. Sans compter qu’il est encore plus facile de caricaturer une gauche supposée voir le monde en rose bonbon quand celle-ci est incarnée par une femme.
Il n’y a plus de système
de valeurs et de représentations
capable de rivaliser avec le modèle dominant
et les idéaux qu’il met en circulation
Toujours est-il que désormais, l’opinion est éduquée à éprouver une haine viscérale envers tout ce qui revendique un progressisme même timide, identifié à l’ennemi : les intellectuels qui trahissent leur mépris du peuple par l’emploi de mots de plus de trois syllabes, les « bobos qui font du vélo à Paris » (Alain Finkielkraut), tout ça n’est qu’un ramassis de privilégiés « angélistes » vivant hors des réalités. Certes, l’image détestable donnée de la gauche par l’establishment socialiste explique en partie ce ressentiment ; mais en partie seulement. Surtout lorsqu’on se rappelle que ce qu’il y a de plus détestable dans cet establishment, c’est sa perméabilité aux valeurs de la droite, et que, pour cette raison, une bonne partie du ressentiment qu’il s’attire provient de gens qui se revendiquent de la gauche - d’une « gauche de gauche », et non de la « gauche de la gauche », selon l’utile correction apportée par Pierre Bourdieu et reprise par Didier Eribon dans son livre. Parmi ceux qui détestent le plus les socialistes, il y en a un bon nombre qui emploient parfois des mots de plus de trois syllabes et qui font du vélo, à Paris ou ailleurs.
Idées, rêves, représentations : c’est tout l’univers mental de la gauche qui est aujourd’hui anémié et discrédité. Pour des raisons en partie externes, et en partie internes. Durant la guerre froide, le communisme était assez puissant et influent pour pouvoir opposer à la culture capitaliste tout un corpus de valeurs et de références alternatives. On pouvait être fier de soi et des siens sur d’autres bases, qui valaient ce qu’elles valaient, mais qui avaient le mérite d’exister - une fierté de classe. Aujourd’hui, il n’y a plus de système de valeurs et de représentations capable de rivaliser avec le modèle dominant et les idéaux qu’il met en circulation. L’une des tâches les plus urgentes et les plus passionnantes, pour les années à venir, pourrait être de rassembler tous les éléments épars qui permettraient d’en rebâtir un ; un ensemble de références, d’idées, de représentations, qui ne serait pas aussi massif que l’a été le contre-modèle communiste - ce ne serait ni possible, ni souhaitable -, mais simplement vivant, cohérent et crédible.
La gauche répugne à accorder
la moindre attention aux formes,
aux discours, aux représentations
Mais il ne faut pas se cacher que la gauche est mal armée pour ça. D’abord, elle répugne à accorder la moindre attention aux formes, aux discours, aux représentations (4). Elle y voit forcément une manipulation, une reddition à l’ennemi, aux techniques de « com’ » prisées par la droite ou les socialistes. Du coup, si elle dénonce à raison - comme Eric Hazan dans LQR, La propagande du quotidien - la façon dont le libéralisme détourne et subvertit le langage à son profit, imposant ses termes comme autant de chevaux de Troie de sa vision du monde (à cet égard, il faut saluer le petit dernier, « assistanat », banalisé au cours de la campagne présidentielle), elle a tendance à s’enfermer elle-même dans un langage routinier, dans le ressassement de slogans usés se limitant à servir de points de ralliement à ceux qui se revendiquent du côté du Bien, avec un souci de renouvellement à ce point inexistant que, pour ma part, je me sens aujourd’hui prête à assassiner quiconque viendrait m’annoncer qu’un autre quoi-que-ce-soit est possible ou que je-ne-sais-quoi n’est pas une marchandise. Elle se berce ainsi d’une autosatisfaction un peu courte, et oublie que la qualité et la force du langage sont intimement liées à celles de la pensée. Annie Le Brun écrivait dans Du trop de réalité que la richesse de la langue apporte à la pensée « le surcroît d’énergie qui permet à celle-ci de s’aventurer au-delà d’elle-même ».
Mais la pensée de gauche a-t-elle envie de « s’aventurer au-delà d’elle-même » ? La question mérite d’être posée. Là encore, elle est hantée par le danger de la trahison. Elle se méfie : les audaces de pensée lui semblent n’être que des prétextes servant à justifier dérives et ralliements à l’ennemi. Et il est indéniable que c’est bien ce qu’elles peuvent être parfois. La surenchère dans la radicalité, déterminante dans la distribution de l’autorité morale, et qui n’est le plus souvent qu’une manière déguisée de jouer à celui qui pisse le plus loin, décourage encore les éventuels candidats à l’aventure intellectuelle. Du coup, la gauche se vit comme un camp retranché : tenter la moindre sortie serait courir le risque de se retrouver en terrain ennemi. Le problème, c’est que, du coup, les provisions s’amenuisent, et seront bientôt épuisées (à ce sujet, voir notamment sur ce site les réflexions de Starhawk et d’Isabelle Stengers).
« Les mots-clés
doivent être “et/et”,
et non “ou/ou” »
Dans un essai consacré au politiquement correct, publié en 1993 et traduit en français sous le titre La Culture gnangnan (Arléa, 1994), le critique d’art du Time Robert Hughes mettait en garde la gauche, dans son propre intérêt, contre la seule attention qu’elle daigne apporter à la langue et à la culture : une attention plus défensive et névrotique que créative, qui consiste seulement à expurger la langue et le patrimoine culturel de leurs éléments jugés potentiellement offensants. S’agaçant d’entendre parler de certains écrivains comme de « Blancs morts », il s’insurgeait contre la tendance réductrice à juger les œuvres uniquement en fonction de leur « capacité à œuvrer en fonction de la conscience sociale », et dénonçait l’illusion selon laquelle « les œuvres d’art portent un message social comme les camions transportent du charbon ». Il rappelait qu’Edward Saïd, l’un des intellectuels qui ont le plus fait pour mettre au jour les valeurs, les inscriptions sociales ou les préjugés décelables dans l’art - notamment dans Culture et impérialisme -, s’est lui-même toujours désolidarisé de cette logique. Il ne s’agit pas de censurer ou de remplacer un corpus par un autre, affirmait-il, mais de mettre d’autres choses en circulation, de créer des points de comparaison, d’encourager autant l’ouverture d’esprit que l’acuité critique : « Les mots-clés doivent être “et/et”, et non “ou/ou”. » Plutôt que de chercher à se protéger de la culture classique ou de la culture de masse - une entreprise improbable, de toute façon, du moins dans la mesure où on ne vit pas en ermite au fond des bois -, instaurer une dialectique entre elles et des œuvres minoritaires capables d’éclairer et de contester certaines de leurs valeurs.
De toute façon, c’est parfois quand elle croit être le plus éloignée du modèle dominant que la gauche s’en rapproche le plus. Elle n’a pas renoncé, par exemple, à sacraliser certains personnages, ou certains pays ou territoires, en raison de leur combativité anti-impérialiste ou de leur capacité à incarner ou à mettre en œuvre des alternatives. Cette sacralisation va au-delà de l’intérêt légitime ou de la simple admiration : elle porte l’espoir fou d’une possibilité de s’affranchir de la pesanteur et de la médiocrité humaines. Les lieux et les personnalités qu’elle concerne sont sanctifiés, perçus comme exempts de toute négativité ou imperfection. Elle rappelle ce militant communiste qui, revenant sur son parcours, racontait dans un documentaire qu’à l’époque, il était persuadé qu’après la révolution, il n’y aurait plus de chagrins d’amour. Ces fantasmes absolutistes, comme l’admiration portée autrefois à l’URSS de Staline ou à la Chine de Mao, peuvent amener à cautionner ou à couvrir malgré soi les pires crimes, plutôt que de devoir renoncer à une illusion bienfaisante. Ils interdisent aussi de faire la part des choses quand il y aurait lieu de la faire : Miguel Benasayag racontait un jour le trouble et la consternation qu’avait semés, dans une communauté autogérée d’Amérique latine, la découverte de la pédophilie de l’un de ses membres. Les uns tentaient désespérément de nier les faits pour sauver le rêve, tandis que, pour d’autres, cette révélation jetait un discrédit brutal sur l’ensemble de l’expérience. Benasayag faisait valoir à raison qu’il aurait pourtant fallu pouvoir inventer une troisième manière de réagir.
Peut-être serait-il temps de se demander
s’il ne peut pas exister quelque chose
entre le puritanisme sinistre
de la gauche authentique
et les orgies cyniques de la gauche caviar
Mais cette idéalisation, si typiquement de gauche qu’elle semble être, a aussi des affinités avec les formes de rêve suscitées par le modèle capitaliste : elle rejoint la logique du people, dans la mesure où celui-ci détourne le rêveur de ce qu’il est, du lieu où il vit, des gens qui l’entourent, pour le persuader qu’ils ne valent rien, et qu’ailleurs, quelque part, il existe des lieux ou des personnes qui sont, eux aussi, « affranchis de la pesanteur et de la médiocrité humaines ». Le confort matériel dans lequel évoluent les stars suscite l’envie en tant que tel, certes, mais peut-être surtout parce qu’on lui attribue inconsciemment le pouvoir de provoquer cette sorte de délivrance, de plénitude mentale - de même que la conformité parfois caricaturale des célébrités aux canons de la beauté est automatiquement synonyme, dans l’esprit du public, de volupté sans limites et d’amour sans nuages. Il ne s’agit pas seulement d’envier ceux qui semblent mener une vie plus gratifiante, plus intéressante ou plus excitante que la vôtre - ce qui, après tout, est compréhensible, même s’il faut aussi se méfier des illusions qui entrent dans ce genre de perception : il s’agit d’entretenir la croyance qu’il existe quelque part une sorte d’Olympe dont les habitants ne sont pas faits de la même substance que les humains ordinaires. A cet égard, l’Olympe de gauche, même s’il n’est pas peuplé des mêmes figures, ne se distingue pas fondamentalement de l’Olympe de droite : il produit les mêmes sentiments d’inanité et d’inadéquation, la même dégradation des réalités particulières. Il pourrait être intéressant de chercher à identifier comme telles - car cela existe, bien sûr -
des formes de rêve qui soient réellement différentes, c’est-à-dire qui enrichissent la réalité au lieu de la rabaisser. Enfin, une autre faiblesse constitutive de l’imaginaire de la gauche provient de sa fidélité au modèle messianique. Il ne peut fonctionner sans la référence incantatoire à un horizon révolutionnaire, à un grand soir, même s’il ne l’appelle pas forcément comme ça. Comme son homologue religieux, il invite ceux qui y adhèrent à se détourner des séductions de ce bas monde corrompu - par le péché pour le christianisme, par le capitalisme pour la gauche -, et à mener une vie d’ascèse et de sacrifices en attendant la rédemption collective. S’y ajoute la logique militaire qui affleure dans le militantisme, et qui, ne voulant voir qu’une seule tête, renvoie toute préoccupation personnelle à un individualisme condamnable. Cette logique affaiblit considérablement la gauche : une révolution n’est jamais exclue, mais elle reste une hypothèse un peu fragile pour qu’on fasse reposer toute la conduite de son existence sur elle. Elle produit avant tout des déceptions et du découragement en rafales. Il doit y avoir un moyen de concilier la recherche d’un but supérieur, la quête de justice ou d’idéal, avec la qualité de l’ici et du maintenant, avec un quotidien qui garde une place pour le plaisir. Peut-être serait-il temps de se demander s’il ne peut pas exister quelque chose entre le puritanisme sinistre de la gauche authentique et les orgies cyniques de la gauche caviar. Et pas le sempiternel hédonisme libertaire et machiste à base de gros rouge et de petites pépées purement décoratives et plus ou moins vénales, s’il vous plaît, culture dans laquelle, bizarrement, je ne me sens pas vraiment de place.
Si la gauche ne sait pas
imbriquer les aspirations personnelles
avec le collectif, si elle persiste à les criminaliser,
il est inévitable qu’elle jette ses ouailles
dans les bras de la droite
Certes, la volonté de distinction et de singularisation est précisément ce sur quoi prospère, en la manipulant et en la fourvoyant, la société de consommation, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il ne s’agit pas d’une quête humaine légitime. C’est peut-être aussi ce désir de ne pas consumer sa vie en vain qui explique la prospérité de la success story : si la gauche ne sait pas ménager un espace aux aspirations personnelles, les imbriquer avec le collectif, si elle persiste à les criminaliser, il est inévitable qu’elle jette ses ouailles dans les bras de la droite, et les pousse à balancer aux orties tout souci du collectif pour saisir la seule chose qui leur semble un peu tangible et stimulante : la réussite personnelle. Bien sûr, les chances d’y parvenir restent des plus aléatoires, mais au moins elles concernent encore cette vie-ci, et n’impliquent d’attendre ni la résurrection ni la révolution.
Ce qu’il y a de génial, avec la success story, c’est qu’elle est immunisée contre la critique. Si vous ricanez des espoirs qu’elle fait naître, vous ne faites que jouer l’un des rôles que sa structure narrative exige : celui du pisse-froid qui rendra le triomphe final encore plus délectable, parce qu’on pourra alors le narguer, savourer son dépit et sa déconfiture, et se sentir d’autant plus de mérite qu’on aura toujours « gardé la foi » et résisté au découragement qu’il essayait fourbement de nous communiquer. On ne peut pas tourner en dérision la success story sans insulter en même temps ce qu’on n’a en aucun cas le droit d’insulter : l’espoir qu’a chacun de faire quelque chose de sa vie. Ce que l’on peut interroger et contester, en revanche, c’est le contenu que le modèle dominant donne à ce quelque chose.
Cette « valeur travail »
qui a hanté la campagne présidentielle
ne produit pas seulement des richesses,
mais aussi des quantités
inépuisables de ressentiment
On peut par exemple se demander si la forme de réussite tapageuse promue par le capitalisme à travers la vitrine du showbiz exercerait la même séduction si elle ne s’appuyait pas sur le désir violent, quoique plus ou moins conscient, de réparer un dommage. Ce dommage, c’est celui causé par la place du travail dans la vie de la plupart des gens. Il est assez frappant de voir que ceux qui, pour des raisons diverses, échappent à cette condition commune, et gardent la libre disposition d’eux-mêmes, partagent rarement les fantasmes majoritaires. Quand elle leur fait défaut, ils ne cracheraient évidemment pas sur un minimum de sécurité matérielle, mais la fortune d’un Johnny ou d’un Jean Reno les laisse de marbre, voire leur inspire une certaine pitié. Ils n’ont rien à compenser, n’aspirent à être dédommagés de rien. Ils sont ailleurs, avec d’autres idéaux, d’autres occupations et préoccupations. Ce qui les distingue, c’est qu’ils acceptent d’assumer la charge d’eux-mêmes, la quête d’un sens à leur vie, qui font si peur à leurs contemporains. Le travail a ceci de diabolique qu’il génère des souffrances, des frustrations, de la rancœur, mais qu’il offre aussi l’occasion d’une fuite, d’une déresponsabilisation. La droite a tout intérêt à encourager cette fuite, à dissuader les gens de se poser la moindre question sur le sens, tant individuel que collectif, de ce qu’ils font : elle sait que cette fameuse « valeur travail » qui a hanté la campagne présidentielle ne produit pas seulement des richesses ; elle produit aussi des quantités inépuisables de ressentiment, qui, habilement canalisées, dirigées contre les chômeurs, les immigrés, les intellos, peuvent lui assurer une suprématie électorale durable.
On voit vraiment mal, en revanche, pourquoi la gauche devrait continuer à cautionner cette mascarade, et se contenter d’aborder le travail sous l’angle de la lutte contre la précarité, comme le fait la « gauche de gauche » - on ne parle même pas du pathétique alignement de Ségolène Royal sur la glorification droitière du travail pour le travail. Elle aurait tout intérêt à initier la révolution culturelle que représenterait la remise en cause du travail sous ses formes actuelles, à être la force politique qui mettrait enfin les pieds dans le plat. Certes, cela impliquerait un courage et une prise de risque considérables. Mais soyons optimistes : au train où vont les choses, elle n’aura bientôt plus rien à perdre.
Mona Chollet
Merci à Thomas Lemahieu,
Fred Levan et Olivier Pironet.





















 En traversant les coursives encombrées de vélos, on se retrouve dans un grand jardin foisonnant de fleurs et d’herbes folles. Les enfants jouent sur les balançoires tandis que les adultes se retrouvent pour bavarder ou boire l’apéro au soleil. Quelques marches conduisent à une librairie de seconde main ; plus loin se trouvent un restaurant bio et exotique où l’addition est à la discrétion du client, ainsi qu’une épicerie bio. En été, le restaurant sort quelques tables à l’ombre de la vieille tour, dans le petit jardin qui offre un havre de calme et de fraîcheur. Adultes, enfants, familles, célibataires, étudiants, salariés, indépendants : au total, environ 450 personnes vivent ici. Parmi eux, beaucoup de musiciens, d’artistes ; mais aussi, par exemple, un physicien, dont les instructions ont permis de fabriquer les capteurs solaires installés sur les toits...
En traversant les coursives encombrées de vélos, on se retrouve dans un grand jardin foisonnant de fleurs et d’herbes folles. Les enfants jouent sur les balançoires tandis que les adultes se retrouvent pour bavarder ou boire l’apéro au soleil. Quelques marches conduisent à une librairie de seconde main ; plus loin se trouvent un restaurant bio et exotique où l’addition est à la discrétion du client, ainsi qu’une épicerie bio. En été, le restaurant sort quelques tables à l’ombre de la vieille tour, dans le petit jardin qui offre un havre de calme et de fraîcheur. Adultes, enfants, familles, célibataires, étudiants, salariés, indépendants : au total, environ 450 personnes vivent ici. Parmi eux, beaucoup de musiciens, d’artistes ; mais aussi, par exemple, un physicien, dont les instructions ont permis de fabriquer les capteurs solaires installés sur les toits...
 Mais c’était sans compter la mauvaise tête de la poignée d’habitants qui, malgré les avis d’expulsion, refuse alors de vider les lieux : essentiellement quelques « irréductibles petits vieux » et quelques jeunes. Ils usent de leur droit à déposer un recours contre le projet, tout en faisant venir leurs copains pour occuper les immeubles. Quand on les évacue, ils reviennent. Quand la police mure les entrées, ils campent dans des tipis dans la cour. Parmi les squatters se trouvent des architectes, qui ont l’idée d’appeler à l’aide le service du patrimoine. Le service des monuments et sites se déplace, et il remarque deux immeubles : il ne va pas jusqu’à les classer, mais il exige que tout ce qui les concerne fasse l’objet du plus grand soin possible - et, pour commencer, qu’on ne les détruise pas ! Or, comme ils sont un peu en diagonale par rapport à la parcelle qui est ronde, il devient impossible de construire le centre commercial... Les propriétaires doivent donc revoir tout leur plan d’aménagement.
Mais c’était sans compter la mauvaise tête de la poignée d’habitants qui, malgré les avis d’expulsion, refuse alors de vider les lieux : essentiellement quelques « irréductibles petits vieux » et quelques jeunes. Ils usent de leur droit à déposer un recours contre le projet, tout en faisant venir leurs copains pour occuper les immeubles. Quand on les évacue, ils reviennent. Quand la police mure les entrées, ils campent dans des tipis dans la cour. Parmi les squatters se trouvent des architectes, qui ont l’idée d’appeler à l’aide le service du patrimoine. Le service des monuments et sites se déplace, et il remarque deux immeubles : il ne va pas jusqu’à les classer, mais il exige que tout ce qui les concerne fasse l’objet du plus grand soin possible - et, pour commencer, qu’on ne les détruise pas ! Or, comme ils sont un peu en diagonale par rapport à la parcelle qui est ronde, il devient impossible de construire le centre commercial... Les propriétaires doivent donc revoir tout leur plan d’aménagement.
 Le répit accordé par le report des travaux est cependant provisoire : avec leurs contrats de confiance, les habitants sont là « à bien plaire », et ils le savent. S’ils veulent avoir leur mot à dire dans la restructuration à venir du quartier, il leur faut devenir des interlocuteurs à part entière pour les autorités. La solution viendra de la suggestion d’un élu - et d’un élu, certes atypique, mais libéral : « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les socialistes, eux, nous ont toujours cassés : ils détestent que les gens essaient de devenir indépendants, ils veulent avoir le beau rôle. Ils nous ont souvent traités d’enfants gâtés, ce genre de choses... Nous , on est trop pragmatiques : on défend notre quartier, alors que les socialistes, eux, défendent le socialisme, ce qui est quand même nettement plus élevé... » Claude Haegi, donc, qui siège à l’exécutif du Canton, conseille aux occupants de se constituer en coopérative d’habitation. De cette manière, la municipalité pourra leur accorder un « droit de superficie » sur l’emplacement de deux immeubles qu’elle possède - dont celui où vit Astrid.
Le répit accordé par le report des travaux est cependant provisoire : avec leurs contrats de confiance, les habitants sont là « à bien plaire », et ils le savent. S’ils veulent avoir leur mot à dire dans la restructuration à venir du quartier, il leur faut devenir des interlocuteurs à part entière pour les autorités. La solution viendra de la suggestion d’un élu - et d’un élu, certes atypique, mais libéral : « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les socialistes, eux, nous ont toujours cassés : ils détestent que les gens essaient de devenir indépendants, ils veulent avoir le beau rôle. Ils nous ont souvent traités d’enfants gâtés, ce genre de choses... Nous , on est trop pragmatiques : on défend notre quartier, alors que les socialistes, eux, défendent le socialisme, ce qui est quand même nettement plus élevé... » Claude Haegi, donc, qui siège à l’exécutif du Canton, conseille aux occupants de se constituer en coopérative d’habitation. De cette manière, la municipalité pourra leur accorder un « droit de superficie » sur l’emplacement de deux immeubles qu’elle possède - dont celui où vit Astrid.
 Mises devant le fait accompli, les autorités ont fini par faire du lieu une vitrine : elles en vantaient elles-mêmes le joyeux « désordre » lors des dernières Journées du patrimoine, en septembre 2000. L’Ilot 13 a alors fait partie des honorables monuments et sites ouverts au public durant un week-end - les habitants ont joué le jeu, ouvrant jusqu’à leurs appartements personnels et suscitant l’émerveillement des personnes âgées en visite guidée. « Dès qu’un truc se passe bien, tout le monde se congratule. Mais au premier problème, il n’y a plus personne ! » râle Astrid.
Mises devant le fait accompli, les autorités ont fini par faire du lieu une vitrine : elles en vantaient elles-mêmes le joyeux « désordre » lors des dernières Journées du patrimoine, en septembre 2000. L’Ilot 13 a alors fait partie des honorables monuments et sites ouverts au public durant un week-end - les habitants ont joué le jeu, ouvrant jusqu’à leurs appartements personnels et suscitant l’émerveillement des personnes âgées en visite guidée. « Dès qu’un truc se passe bien, tout le monde se congratule. Mais au premier problème, il n’y a plus personne ! » râle Astrid.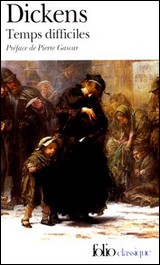 On pense à M. Bounderby, le banquier du génial roman satirique de Charles Dickens
On pense à M. Bounderby, le banquier du génial roman satirique de Charles Dickens 

